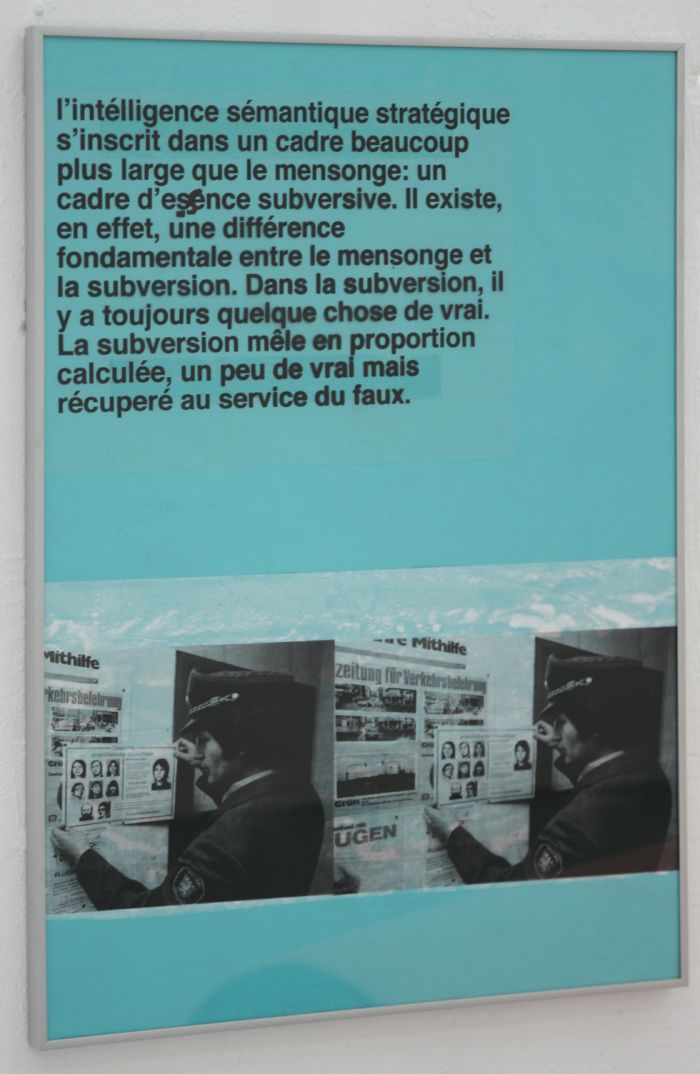exposition collective / passée
Des lieux de digression #2

Un acte de langage, son inscription comme texte, procèdent toujours d’un paradigme spatial parfaitement régulé : il faut respecter scrupuleusement la succession comme les écarts constitutifs entre chaque composant pour dérouler correctement le propos. La « bonne formulation » réclame cette « bonne forme » qui est toujours question d’espacements - ceux-là, indispensables, qui structurent l’assemblage en un tout cohérent, qui le composent pourrait-on dire afin d’articuler le parallèle entre le champ de la littérature et celui des arts plastiques. Ce sont, pour exemple, les intervalles conjonctifs que constituent les blancs typographiques, rendant distincts les différents éléments imprimés tout en en garantissant du même coup l’ordre, et la liaison. L’habitude aidant, il est facile d’oublier que ces césures servant l’enchaînement ne sont que convention. Un protocole, au caractère nécessairement coercitif – dont le dessin participe bien sûr d’un dessein, conditionnant l’intelligibilité de l’ensemble. D’où l’importance de cette notion de digression qui, par essence, met en jeu tout modèle de spatialisation, donc la conception même de l’œuvre.
Maude Maris : marquer l’éloignement
Détour dans le récit, pause dans le discours, invite à s’éloigner de la droite linéarité : la digression met en balance la maîtrise et l’écart. Sans elle l’œuvre se dévide, lisse, unie, homogène, sans présenter ni résistances, ni surprises. On voit où l’on va, où l’on veut en venir. A l’inverse, la présence d’une digression présage que l’on s’égare, donc quant à l’œuvre qu’on n’en contrôle plus tout aussi scrupuleusement la marche. C’est en ce sens que Maude Maris en use dans sa dernière série : voilà qu’un des fragments qui composent les toiles de la Réserve lapidaire n’est pas traité avec la même rigueur réaliste que ceux qu’il avoisine. Le glacis est plus souple, la touche presque perceptible, en tous cas les bords de l’objet moins francs ; et ce léger flou, cette relative imprécision suffit, par contraste, à lui donner du champ, à marquer un certain éloignement d’avec le reste de l’agencement. Ce désordre subtil s’inscrit dans la minutie de l’ensemble comme une soudaine inconstance, une sortie vagabonde. Dans les travaux les plus récents de Maude Maris cette texture indécise cède même, sur un élément juste en périphérie, à quelque chose tout en matière plus largement brossée. C’est le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac pris à rebours. L’indice d’une dérive erratique venant encore appuyer le morcellement, cette logique de fragmentation dont ces peintures par ailleurs si précises, décidées et méticuleusement détaillées, travaillent paradoxalement à souligner l’inachèvement.
Sophie Nicol : déréguler le rapport figure-fond
Lorsque, par digression, les intervalles constitutifs du discours – ou les distances constitutives de la représentation, c’est égal – ne sont plus respectées, alors peut advenir un désordre qui permet de nouvelles formulations. C’est le cas avec le travail de Sophie Nicol, qui dans ses tableaux s’attache à déborder l’utopie moderniste d’une « bonne forme » fondée sur le rapport figure-fond, en proposant des développements parasites. A voir ses œuvres, elle respecte pourtant a priori le cadre référentiel cher à la Gestalt : il s’agit encore là de formes qui se détachent sur un fond. Mais voilà : ici la forme n’est pas cette incise mesurée, placée, circonscrite, que l’on attend dans l’articulation classique des espaces. Les modules géométriques cadrés presque systématiquement plein centre envahissent la surface jusqu’à ne laisser qu’un maigre bord, parfois seules quelques bribes d’arrière-plan rejetées aux pourtours. Ils encombrent la toile, l’obturent quasiment, bloquant toute échappée vers cette profondeur reléguée à la circonférence. Tant et si bien que comme le regard se concentre sur ces formes géométriques, prismatiques, qui viennent troubler l’orientation et la spatialisation de l’ensemble, le plein tend à se lire en creux, la forme à se rabattre en fond. Par ces jeux de proportions et de composition dérégulant partiellement la relation classique de la figure à son contexte, Sophie Nicol trouve une possibilité au cœur même de la forme pour l’éroder : les espaces qu’elle travaille, plus seulement fondés sur la différenciation des objets avec le milieu ambiant, incluent également ces contre-formes qui viennent creuser le premier plan sans pour autant se résoudre à coïncider avec quelque chose de l’ordre d’un arrière-fond.
Jean-François Leroy : l’enchaînement digressif
Jean-François Leroy a entre autre protocole de travail de toujours considérer ses réalisations comme autant de matières premières – ré-utilisables, re-convertibles, toujours commuables –, à partir desquelles il initie un Œuvre spiralaire et potentiellement infini. Cette décision d’opter ainsi pour un continuel réagencement est relativement ambivalente : à la fois structurante en tant que problématique, mais également déroutante, parce que basée sur un jeu d’incessantes transformations. De fait, ce travail montre à la fois une indéniable continuité – puisque la reprise des pièces antérieures génère une certaine familiarité –, mais sans s’astreindre à ce que la succession soit des plus fluides, ni des plus rigoureuses. Bien au contraire, l’ensemble fonctionne par sautes. En pointillés, et par déliaison. Comme si certaines étapes avaient été volontairement biffées dans l’enchaînement. Les pièces de Jean-François Leroy semblent des instantanés, propositions incidentes d’un état perpétuellement instable parce qu’en devenir. Cela explique en partie pourquoi ses compositions jouent tant du vocabulaire de la digression : la multiplication des correspondances et des déviations, ces embardées rompent le bon déroulement de la suite. Marques de fabrique, elles lui assurent de conserver une parfaite cohésion d’ensemble en lui permettant du même coup de s’affranchir de toute linéarité.
Loïc Blairon : la représentation du débord
Les travaux récents de Loïc Blairon consistent en l’accroissement de certains espaces. Partant d’un couvercle de piano ou d’une tête de lit renversés à la verticale – et laissés, sinon bruts, toutefois relativement identifiables –, il développe ses volumes en de larges blocs blancs qui viennent étendre le panneau initial, mais sans jamais rejouer au final la silhouette du mobilier référent. Le débord est tel que dans le nouvel ensemble la pièce source s’égare ; comme le sujet principal souffre toujours d’une incise disproportionnée. Car Loïc Blairon dilate ces formes sans pour autant se contenter de les amplifier. S’il les rallonge, les augmente, ce n’est pas par la simple translation d’un plan dont le profil serait réitéré plus loin, mais toujours vers l’ailleurs. Il est dans ces sculptures question d’éloignement, de cette prise de distance qui menace de perdre de vue les champs discursifs et cognitifs originaires du propos – ce qui est peut-être une autre façon de questionner l’obligation de concision que l’on associe d’ordinaire à la pertinence. Dans une économie symbolique où l’à-propos équivaut à la brièveté, et s’installe dans l’espace le plus restreint alors que son antonyme relève toujours d’un écart trop important, Loïc Blairon choisit explicitement le déploiement digressif avec ces pièces d’apparences pourtant minimales mais qu’il ne faudrait trop rapidement ranger du côté du fameux less is more. Il travaille à rebours ce hors-propos généralement dénoncé par recours à l’image du lointain et de la surabondance, et très justement matérialisé ici dans ces vastes pans blancs animés de variations subtiles de textures venant donner corps à cet effet de longueur du débordement.
Benoît Géhanne : une pratique discursive de l’illisibilité
Le travail de Benoît Géhanne consiste à mettre en place des conditions venant contrarier toute immédiateté de lecture. Il produit des images (peintures, dessins, photographies), puis enraye les mécanismes qui favoriseraient leur réception. Ceci non en manipulant l’image elle-même mais en travaillant son contexte de présentation, dont il exagère les contraintes : comme avec ces Biais qui forcent à scruter le peu laissé visible d’une photographie tapie au fond d’un angle aigu, ou les Intercalaires coinçant plages de couleurs, dessins et impressions entre des intervalles ne permettant d’y couler qu’un regard rasant. L’image, donc, s’escamote. Parce que dans ces pièces l’élément photographique, figuratif, est toujours astreint à un contexte qui l’outrepasse – confiné dans un espace bien trop restreint pour en permettre l’envisagement, relégué à un emplacement subsidiaire, un rôle subalterne, paraissant parfois enchâssé comme un fragment parasite. Cette mise à l’écart systématique oblige ainsi l’image, la représentation, à descendre de leur piédestal pour endosser la place et la nature habituellement dévolues aux parenthèses digressives ; elle les marginalise du propos. Par ces choix de composition, Benoît Géhanne énonce un objectif métadiscursif : une volonté d’engager une réflexion critique sur l’image elle-même. Ses œuvres jouant d’un continuel déclassement des images sont une invite à vérifier l’inanité de ces poncifs issus des standards de la communication médiatique, et selon lesquels l’image répondrait d’impératifs de lisibilité et de clarté. Les utiliser en lieu et place de digression lui permet au contraire de souligner toute l’importance des possibles auxquels ouvre l’équivoque.
Miquel Mont : perturber le système rhétorique
La principale condamnation à l’encontre de la digression insiste sur le fait qu’elle brouille le propos, le rende confus voire incompréhensible – en bref, on lui reproche la perte du discours initial. La série de Lapsus réalisée par Miquel Mont joue de ce ressort. Ces pièces répondent toutes du même protocole : d’une part la peinture, directement appliquée sur le mur pour rendre une figure géométrique simple, puis le support, découpe d’une figure analogue dans un matériau laissé brut – carton, plexiglas, placoplâtre… –, à côté, posé à champ. Deux formes donc, composées en symétrie axiale ; sauf que l’une et l’autre ne sont justement pas équivalentes. Et ce qui était censé former une somme unifiée se retrouve défait par une sorte de dérive digressive qu’induit ce travail sur la disparité des éléments. Comme le mot qui vient à la place d’un autre, refoulant une partie de la signification, le lapsus ici c’est cette mise en relation qui, jouant de la désunion d’un ensemble auguré comme tel, vient modifier le sens attendu de la composition. Là où le vis-à-vis en miroir laisse présager l’exacte similitude, Miquel Mont introduit quelques données litigieuses afin de venir perturber le système rhétorique qu’il convoque. Par cette inadéquation d’une forme à l’autre et du dispositif de symétrie utilisé au rendu final, il manque exprès la cible, réaffirmant que la mise en œuvre n’est pas nécessairement une assimilation réussie au terme d’un parcours vers un référent plastique ou théorique auquel il s’agirait de coïncider.
œuvres exposées
vue de l’exposition